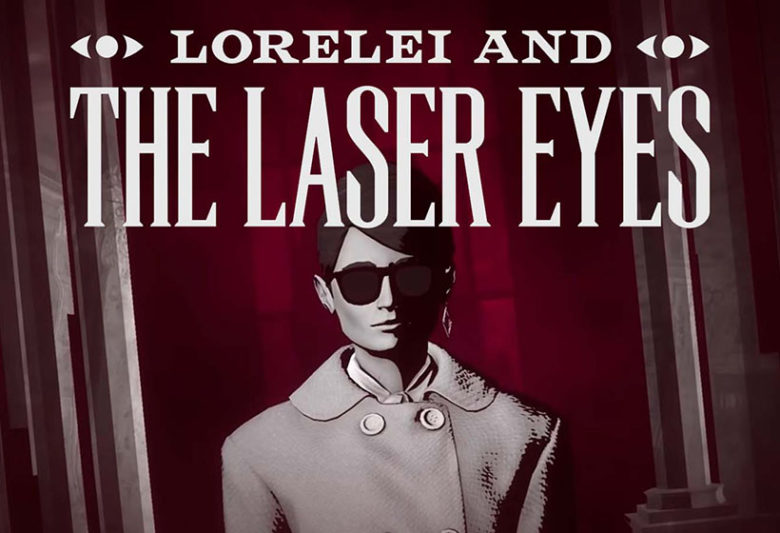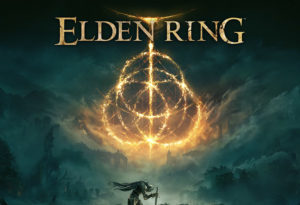Avant-propos
Après deux années consécutives à m’essayer à la tenue de ma liste annuelles des jeux que j’ai parcourus, partiellement ou jusqu’au bout, force est de constater que j’ai désormais pris l’habitude. Tenir mon tableau à jour est même devenue en 2024 une quasi nécessité, au vu de la manière dont s’était terminée l’année précédente. Un fort besoin d’ancrage s’est fait ressentir tout le long, dû en grande partie à ma sortie d’une phase extrêmement difficile, au cours de laquelle rien ne parvenait à me faire envie, ni à rester dans ma mémoire. 2024 fût donc l’année où j’ai le plus joué depuis sacrément longtemps, et à défaut de m’être beaucoup impliqué dans le milieu associatif (en partie parce que j’en avais bien trop fait en 2023), cela m’aura permis d’approfondir certains genres particuliers qui me faisaient envie depuis très longtemps, notamment sur le plan de l’analyse. Si 2023 était une année particulière sur le plan social et associatif, l’année suivante a surtout rimé avec reconstruction et isolement relatif. De même, les podcasts initiés pendant cette année faste sont encore actuellement en pause indéterminée, et l’écriture de nouvelles n’a été que très parcellaire, n’ayant pas récupéré suffisamment d’énergie en 2024 (et partiellement maintenant, arrivé à mi-2025). Au vu de mon état actuel (stable mais à l’énergie fragile), ce n’est toujours pas cette année que ce blog sera alimenté par autre chose que des rétrospectives, qui me prennent déjà assez de temps (surtout à cause de ma méthodologie, ou plutôt absence de celle-ci, qui fait que je dois toujours refaire des recherches sur des jeux dont j’avais des tonnes de choses à dire le mois de leur complétion, mais que je n’ai noté nulle part). Mais au moins, je suis à présent à jour sur mes rétrospectives, et j’ai beaucoup de choses à dire donc commençons.
Approche plus ciblée
Après une année à écumer le Game Pass et globalement jouer au maximum d’expériences différentes, en terme de setting, ambiances ou encore mécaniques, j’ai commencé à opérer un virage radical en 2024, avec pour axe principal l’horreur. Et plus précisément, plutôt vers des expériences déroutantes, étranges, surréalistes, tant au niveau de la présentation, la narration, ou encore le gameplay. Mon approche, de plus en plus réfléchie, est la suivante : jamais je ne pourrais rattraper tous les jeux de tous les genres qui m’intéressent de près ou de loin, surtout en prenant en compte la tendance actuelle de l’industrie à saturer les stores de nouvelles productions tous les mois. Ce n’est juste pas tenable, et quand bien même, le jeu vidéo a beau être mon intérêt spécifique principal, bien d’autres choses m’animent, faisant souvent des liens avec des sphères similaires (littérature fantastique/horrifique, cinéma de J-horror, attrait pour les musiques extrêmes souvent très proches en terme d’iconographie, etc.). Il a donc fallu faire des choix. L’art sombre, la dark fantasy et autres joyeusetés m’ont toujours intéressé de plus ou moins loin selon les périodes, mais je savais que quelque chose se jouaient entre ces univers et moi, et plus le temps passait, plus le contenu (Youtube ou encore articles de blog) que je consommais tendait vers de l’analyse assez poussée de la scène JV horrifique. Le choix s’est donc fait assez naturellement porté vers celle-ci, et ma plongée dans ce passionnant rabbithole s’est amorcé, ne me laissant que très peu de temps pour les autres aspects du jeu vidéo à partir de ce moment-là. Si toutes les entrées de cette rétrospective ne rentrent pas forcément dans ce carcan, il est évident que ça reste toute de même la grosse majorité de mon temps de jeu en 2024, surtout passée la première moitié de l’année.
De par la particularité de ma situation en début d’année, le PC s’est très vite présenté comme la plateforme principale sur laquelle j’ai été tout au long de 2024. Ayant passé de longs mois allongé, sans aucune énergie, et incapable de retenir quoi que ce soit malgré tous mes efforts, l’action de jouer assis à mon bureau avait quelque chose de presque galvanisant, déjà parce que j’avais retrouvé goût à quelque chose, mais aussi et surtout car cela paraissait plus actif sur le moment. Sur les 79 jeux, dont 72 terminé, que j’ai parcourus tout au long de l’année, seulement 18 ont été joués sur une autre plateforme que le PC. En répartition, on a donc une majorité sur le Game Pass, avec 8 jeux, puis la Switch et la Xbox 360, avec respectivement 3 et 2 jeux, puis viennent la PS4, la Xbox, la GameCube et le PS1 avec chacun un jeu. Et sur l’ensemble du corpus de jeux faits en 2024, au moins 37 sont directement liés à l’horreur, sans compter les jeux n’en étant pas explicitement mais portant en eux des éléments, narratifs, visuels voire même mécaniques, qui pourraient tendre vers l’esthétique que je recherche désormais. À savoir que mon rattrapage du genre ne s’est initié que début Juillet, avec le premier jeu ouvertement horrifique terminé le 12 du mois. Et à partir de cette date jusqu’à la toute fin de l’année (littéralement le dernier jour), l’extrême majorité des entrées de la liste se trouvent être des jeux présentant à minima une esthétique sombre et/ou surréaliste, et sinon de la pure horreur. En comparaison, les six premiers mois de l’année étaient plutôt rythmés par des expériences relativement colorées, fruits d’un besoin de retrouver goût à ma propre vie. Et donc, comme tous les ans depuis le début des rétrospectives, une partie de cette période a été fortement marquée par la suite de mon rattrapage de ma désormais série de cœur, Yakuza (ou Ryu ga Gotoku, ou Like a Dragon, faites comme vous voulez). Mais avant de faire l’inventaire de mes meilleurs rattrapages, j’aimerai mettre en lumière mon jeu de l’année 2024, celui qui m’aura le plus fasciné, et contrairement à ce que je pensais au vu de mes attentes en termes de sorties, celui-ci reflète finalement très bien la dynamique qui a rythmé toute mon année.
Cas particulier
Comme l’an passé, plusieurs choix s’offraient à moi, dont un que je n’ai pu rattraper qu’en 2025, mais qui aurait très probablement été mon jeu de l’année (Metaphor Refantazio). Tout d’abord, si on se base uniquement sur le temps de jeu, j’aurai pu choisir le remake de Persona 3, sous-titré Reload, qui est à mon sens une des meilleurs entrées de la série, et la version à privilégier pour se familiariser avec l’univers relativement connecté de cette incroyable saga. Basé sur le moteur de Persona 5, tout a été retravaillé, jusqu’au fabuleux l’interface design déjà à l’œuvre chez P-Studio depuis Catherine en 2011, et même certains points d’accroche narratifs, secondaires certes, mais néanmoins problématique (la transphobie banalisée notamment, c’est malheureusement une récurrence dans Persona) ont été corrigés et adaptés. Le résultat est impressionnant, et je n’ai qu’une hâte, dévorer le remake du quatrième épisode, très récemment annoncé, surtout si le studio parvient à faire son auto-critique concernant le contenu méprisant envers certaines minorités. Cette année était également sorti le DLC d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, dont le contenu justifierait presque une sortie en standalone. Rien de plus à en dire, je suis complètement dévoué à la cause From Software, mais ça allait finir par se voir donc je me contiens. Et sinon, agréable surprise, j’aurai également pu sélectionner le remake de Silent Hill 2 (oui, encore un remake), dont la sortie m’inquiétais fortement, dans la mesure où la Bloober Team a parfois tendance à assez mal traiter certains sujet proches de ceux rencontrés dans SH2. Mais je dois le reconnaître, bien que la durée de vie soit un poil grande (ce qui influe sur le pacing, pas toujours très agréable), le travail fourni pour retaper ce chef-d’œuvre du survival-horror (et même du jeu vidéo de manière général) ne peut qu’être salué. Mécaniques de combat largement revues, progression différente et jouant beaucoup avec nos attentes de fans de la série et de l’original, accent mis sur la justesse des interactions entre personnages, tout a été particulièrement soigné et je ne peux que le conseiller.
Finalement, mon jeu de l’année s’est révélé très tard, courant décembre très précisément (terminé le 23), et c’est Lorelei and the Laser Eyes. Développé par un petit studio Suédois, à qui l’on doit notamment Sayonara Wild Hearts ou encore Year Walk, le jeu se présente comme une sorte d’escape game dans un manoir à la troisième personne. Le cœur du jeu s’articule autour de ses énigmes, faisant même intervenir… les maths. Oui. L’ayant découvert dans la vidéo dédiée de Pseudoless, cet aspect en particulier m’avait fortement rebuté, mais maintenant que j’ai pu démêler son mystère dans son intégralité, et résoudre toutes ses énigmes, je ne peux que me féliciter d’avoir persévéré et osé me lancer dans l’aventure. Car Lorelei and the Laser Eyes est incroyable. Sur le plan esthétique tout d’abord, et de par ses influences notamment, oscillant entre surréalisme à la Dario Argento, effets de style inspirés par les productions Grasshopper Manufacture, influence colorimétrique et de mise en scène de l’expressionnisme allemand, ou encore toutes ses références plus ou moins appuyées au jeu d’aventure graphique des 90’s ou à l’âge d’or du survival-horror, Resident Evil en tête (surtout quand on voit la forme des lieux, et la structure de son level design et sa progression). Mais là où le jeu brille, c’est sur son concept même, qui structure l’intégralité de l’expérience, du scénario aux différentes briques de gameplay. Concernant la partie narrative du titre, le postulat est le suivant : nous sommes invitée par un réalisateur italien renommé à prendre part à son projet artistique, prenant la forme d’énigmes disséminées dans un vieil hôtel aux allures de manoir. C’est donc à nous de démêler le déroulé d’un supposé script de film, brouillant la frontière entre réel et imaginaire, le tout par le biais d’un nombre conséquent d’énigmes de toutes sortes, jouant parfois sur leur énoncé, les informations recueillies dans un document, beaucoup de déductions via l’environnement, ou encore par le biais de systèmes et points de vue différents (visual novel, texte ou encore prototype de jeu PS1). Si l’ergonomie n’est pas toujours au rendez-vous (le fait d’avoir limité les inputs à un bouton fonctionne dans la plupart des cas, mais peut donner lieu à des situations frustrantes, comme être obligé de rater une énigme pour sortir, le bouton précédent n’étant pas implémenté), le reste de ses éléments se répondent si bien, le résultat final est si cohérent est tellement meilleur que la somme de toutes ses parties (qui sont déjà indépendamment excellentes), que si le concept vous accroche, je peux vous assurer que le jeu vous restera longtemps en tête. See it all through laser eyes.
Mes meilleurs rattrapages
1. Paradise Killer

Afin de commencer ce tour d’horizon de mes rattrapages 2024, quoi de mieux que la seule entrée dénotant complètement du reste ? Si certaines thématiques abordées dans Paradise Killer pourraient s’apparenter à de l’horreur, tout dans le projet, de la direction artistique à l’incroyable OST, en passant par son écriture, notamment des dialogues, alliant légèreté bienvenue et justesse de ton, tend plutôt à nous offrir une expérience plaisante et surréaliste, en dépit du postulat de base. Mais avant d’étayer un peu plus mon propos, une mise en contexte, comme toujours, s’impose. Sorti sur PC et Switch le 4 septembre 2020, puis sur les autres plateformes deux ans plus tard, Paradise Killer prend la forme d’un jeu d’enquête à la première personne, rappelant fortement des projets comme Danganronpa, le tout sur une île en zone ouverte. Bien que les références soient à aller chercher principalement du côté du jeu de niche japonais (les productions Spike Chunsoft pour les mécaniques, encore et toujours Grasshopper Manufacture pour la direction artistique et l’ambiance relativement surréaliste, à base d’aplats de couleurs plutôt vives et univers rempli de personnages flingués), son studio, Kaizen Game Works, est d’origine britannique. Structure originellement formée par deux vétérans de l’industrie en 2018 (la core team étant encore actuellement constituée de trois personnes), il faudra donc attendre seulement deux ans avant que Paradise Killer ne sorte. Et quelle première sortie ! Si l’aspect mécanique reste assez limité, somme toute assez logique pour le genre représenté, le niveau de finition global est assez remarquable, et ce dans tous les aspects de sa conception.
Afin de vénérer leurs divinités cosmiques décédées, un groupe d’immortels nommé le Syndicat créa la première île Paradis, avec comme ultime but de ressusciter les dieux en forçant les citoyens de l’île à effectuer des rituels psychiques. Mais ceux-ci finissent toujours par provoquer une incursion démoniaque depuis l’espace profond, menant systématiquement à l’échec du Paradis. Un nouveau cycle recommence, menant irrémédiablement à la chute de l’île suivante, car la corruption finit toujours par trouver un chemin. Au cours de l’itération 13, Lady Love Dies (notre personnage, membre du Syndicat et accessoirement détective) mettra en péril le Paradis en se faisant duper par un des dieux que le Syndicat, Damned Harmony, et sera de fait condamnée à un exil éternel. Ce cycle ainsi que les 11 suivants seront un échec, menant au projet d’une ultime île, nommée Perfect 25. L’île 24 était portant presque parfaite, jusqu’à ce qu’un citoyen nommé Henry Division se rapproche trop des dieux et provoque une invasion démoniaque sur le Paradis. Les citoyens furent de nouveau massacrés en sacrifice et le Conseil, groupe chargé de concevoir les séquences d’îles, se retira afin de méditer en prévision de Perfect 25, mais tous ses membres furent assassinés avant qu’ils ne purent terminer. Un meurtrier ne peut décemment pas se trouver dans l’île 25, prévue comme parfaite, et Lady Love Dies est donc tirée de son exil afin de lever le voile sur ce multiple meurtre, et démasquer la personne qui a voulu littéralement tuer le Paradis. C’est à ce moment-là que le jeu commence vraiment.
Au vu de ce bref résumé, vous aurez sûrement remarqué pourquoi, en plus de son esthétique et ses emprunts à des références qui me parlent à la base, cet univers m’a autant fasciné. C’est simple : si je n’avais pas dès le départ évoqué l’ambiance très plaisante, on serait en droit de s’attendre à un setting et une ambiance bien plus sombres, tirait même du côté de l’horreur cosmique. Et pourtant, en dépit de son world building relativement cauchemardesque, l’île sur laquelle on sera amené à déambuler durant la petite dizaine d’heures que compose l’aventure est au contraire étonnamment agréable, reposante même. Une sensation probablement assez largement induite par la musique du jeu, intégralement diégétique (des émetteurs radio sont disséminés partout sur la surface de l’île, donnant du corps aux compositions car leur diffusion se fait en fonction de notre emplacement dans l’espace), et donnant dans de la vaporwave, synthpop et tirant parfois sur la synthwave. De plus, le style globale du jeu (son architecture, chara design, écrans fixes divers) parvient à trouver un juste équilibre entre vaporwave surréaliste, édifices antiques et quartiers relativement futuristes, renforçant la singularité de la proposition.
Mais si son esthétique est singulière, son game design n’en est pas moins intéressant, à commencer par le but du jeu. Concrètement, un seul objectif principal nous est donné en début de partie, résoudre le meurtre du Conseil, et c’est à nous de démêler le vrai du faux, ou bien de nous en remettre à l’avis général et juger Henry Division, l’auteur de la corruption démoniaque, coupable du crime, bien que rien hormis ses liens avec les démons ne puisse vraiment justifier ce choix. Ce qui veut dire qu’il est tout à fait possible de terminer le jeu en une dizaine de minutes, et rien dans la narration ni dans les instructions nous suggèrent qu’on a fait le mauvais choix. On a juste souhaité arriver à cette fin, et c’est totalement acceptable. Mais prendre cette décision nous priverait de l’exploration de l’île, d’en découvrir ses secrets et son histoire (ainsi que celle des autres séquences), de rencontres tantôt familières et agréables (comme avec certains membres du Syndicat, avec lesquels on peut développer nos liens), tantôt particulièrement irréelles, comme avec certaines divinités cosmiques vénérées en ce lieu. Le cœur du jeu, à savoir son enquête, la recherche de la vérité et donc la déambulation dans cette aire de jeu si reposante, est finalement presque optionnel. Et ce malgré tout un pan de l’interface (via un ordinateur) qui sert à tenir des notes lors de notre investigation, faire des liens entre les personnages, et arriver progressivement à la vérité, du moins celle qui nous arrange le mieux. Mais je peux vous assurer que ça vaut le coup de pousser plus loin. Ce fut l’un des premiers jeux dans lesquels je me suis complètement abandonné en début d’année 2024, après plusieurs mois très difficiles, et encore maintenant celui-ci, ainsi que son incroyable OST, me reste en tête, et le sera probablement encore pendant longtemps.
2. SOMA
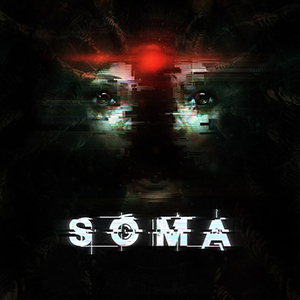
Il est désormais temps de parler d’un grand studio de l’horreur moderne. Si SOMA, le jeu que je vais présenter, vous est éventuellement étranger, il est plus que probable que vous ayez au moins entendu parler de la production qui a propulsé Frictional Games sur le devant de la scène horrifique indépendante, émergente à partir de la fin des années 2000. Je veux bien entendu parler d’Amnesia The Dark Descent, sorti en 2010. Le fournisseur principal de let’s plays d’horreur de l’époque. Un jeu auquel je m’étais essayé quelques années après sa sortie sans grande conviction, n’étant alors pas encore tombé dans mon obsession maladive pour l’horreur. Si la couche narrative ne m’avait lors de ma progression pas échappée (en même temps, difficile de passer à côté), celle-ci ne m’avait pourtant pas laissé un souvenir intarissable. Il est même possible que la trame globale, ses détails et sa portée ne m’aient même pas frappé à ce moment-là. De même, si le jeu s’appuie sur des mécaniques très efficaces (qu’on pouvait déjà partiellement trouver dans des références plus anciennes telles que Clock Tower ou encore Hellnight), j’ai mis du temps à reconnaître son influence, tant sur la narration que sur le game design de beaucoup de productions horrifiques qui vont suivre. La faute à un désintérêt pour le genre en tant qu’objet d’analyse à l’époque, plutôt utilisé comme vecteur de frissons qu’autre chose. Et aussi parce qu’une progression reposant majoritairement sur le fait de se cacher dans des placards ou sous des lits ne m’aguichait pas vraiment. À savoir que c’était également quelques années avant ma découverte de l’œuvre de Howard Philips Lovecraft, dont Frictional tient la quasi totalité des thématiques et inspirations diverses, au point même de nommer leur moteur HPL Engine, des initiales du Maître de Providence. Mais le temps passant, ma vision de ce qu’a représenté (et représente toujours) Amnesia a considérablement changé, m’amenant même à envisager découvrir une autre production signée Frictional Games, sortie après leur succès massif avec ce dernier. Et comme la vie est bien faite, c’est le sujet de cette partie.
Plusieurs choses ont donc changé en douze ans. Tout d’abord, un intérêt grandissant pour l’horreur, son esthétique et ses divers axes d’analyse, d’ailleurs souvent lié à l’horreur cosmique, surréaliste ou existentielle. Mais également un rattrapage massif du travail de Lovecraft, qui m’aura même inspiré dans l’écriture de mes propres nouvelles, chose à laquelle je pensais depuis tant d’années. Profitant de ce moment propice, je me suis donc décidé à enfin lancer SOMA, qui traînait dans ma bibliothèque GoG depuis maintenant un bon paquet d’années. Sûrement donné lors de soldes sur la plateforme ou récupéré dans un bundle, je ne saurai le dire précisément. J’allais pouvoir découvrir ce que Frictional Games, forts de leur expérience sur la trilogie Penumbra dans les années 2000 (qu’il faudra un jour que je rattrape, le potentiel existentialiste étant apparemment relativement costaud), puis d’Amnesia The Dark Descent (laissant un autre studio, The Chinese Room, en charge de la production d’A Machine For Pigs, mais c’est un autre sujet, sûrement pour une autre fois), étaient désormais capables de faire 5 ans après la sortie du hit qui les avait sortis de l’underground. C’est donc en 2015 que sortira SOMA, qui prendra cette fois beaucoup plus la forme d’un walking sim avec des segments d’horreur de la formule mise en place avec Amnesia, ce dernier jouant quant à lui plutôt la carte du survival-horror à la première personne. Le jeu s’ouvre sur une brève introduction dans l’appartement de Simon Jarrett, notre personnage, à la même époque que la sortie du jeu (2015 donc) et vraisemblablement à Toronto. Après quelques menus objectifs nous familiarisant avec les systèmes de jeu (et profitant du superbe moteur physique déjà à l’œuvre sur Amnesia), nous nous dirigeons vers un cabinet, dont on déduit assez vite le caractère officieux, en vue de passer un scanner cérébral, censé agir sur la reconstruction mémorielle (un flashback en début de jeu nous laissant penser que Simon aurait eu un accident de voiture particulièrement grave ayant endommagé son cerveau). Comme il fallait s’y attendre, quelque chose arrive lors du scanner, et nous sommes transportés… ailleurs ? Les nouveaux lieux, complètement étrangers, paraissent tout droit sortis du futur, et complètement déserts, dénués de vie. Très vite, on se rendra compte que l’endroit où Simon a atterri se trouve en fait sous l’eau, et que celui-ci n’est peut-être pas si désert qu’escompté. Mais ce n’est en rien une bonne nouvelle.
Si l’entrée en matière semble assez peu originale, voire même clichée sur certains aspects, les évènements prendront très vite une tournure étonnante, créative, et surtout profondément existentielle. Concrètement, le jeu se présente comme un walking simulator avec puzzles environnementaux et logs en tous genres à décortiquer pour en apprendre plus sur la trame globale, avec des segments spécifiques donnant lieu à du hide and seek (à noter qu’il existe un mode de jeu retirant l’intégralité de ces phases, renforçant son focus sur la narration), de la même manière qu’Amnesia. Sauf que, là où ce dernier tentant de donner de la cohérence à sa progression en mêlant les deux phases, exploration et courses poursuites, SOMA a pris le parti de laisser respirer son rythme le plus possible. Car même si les phases de poursuites ont du sens, dans la narration et dans le level design, l’emphase du titre est clairement mise sur l’ambiance et la réalisation des véritables horreurs de ce monde, le tout dans un slow burn assez remarquable et souvent très juste dans leur déroulé. Tout a été réduit à son strict minimum par rapport à Amnesia. Plus d’inventaire, de gestion de la santé mentale, ou encore des lumières à allumer ou non selon le contexte. Ici, notre personnage dispose d’une source lumineuse illimitée, ne souffre pas dans l’obscurité, et les adversaires sont globalement plus faciles à esquiver. Un élément, qui me plaît tout particulièrement, a quand même été conservé, et sied particulièrement bien à un jeu disposant de ces mécaniques et thématiques. Il est impossible d’avoir une vision claire des ennemis qui nous chassent. Chaque fois que notre personnage s’approchera trop, l’écran se brouillera au niveau du monstre, nous laissant une marge de mystère, bien plus propice à la peur. C’est quelque chose que je remarque souvent dans les jeux à plus petit budget qui doivent miser sur leur inventivité par rapport aux grosses productions horrifiques : les imprécisions visuelles, qu’elles soient techniques ou volontaires, offrent souvent une vision bien plus terrifiante qu’une modèle très détaillé dont on voit toutes les coutures. De la même manière qu’au cinéma. SOMA est donc relativement sobre dans son approche mécanique de l’horreur, et n’essaie pas de nous impressionner avec sa progression, mais va plutôt chercher à s’imprimer durablement dans nos cerveaux avec ce qu’il veut nous raconter, et surtout comment il va le raconter. Ses thématiques, tournant autour de l’intelligence artificielle et de l’existentialisme, restent assez courantes dans les œuvres du genre, mais la manière dont il va les mettre en scène, et en particulier dont il va nous faire les expérimenter par le gameplay, est ce qui différencie SOMA de la majorité des jeux du même genre auxquels j’ai pu jouer. Ce n’est peut-être pas le meilleur jeu vidéo dans le sens le plus pur du terme, mais c’est probablement l’un des meilleurs scénarios de ce genre de l’horreur, qui parvient brillamment à développer sa narration par le gameplay, et qui, si vous êtes sensibles à sa proposition, pourra vous marquer longtemps.
3. Stories Untold
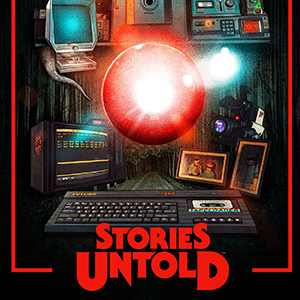
Si SOMA pouvait éventuellement parler à suffisamment de monde, notamment de par sa filiation avec Amnesia et par extension Frictional Games, cela m’étonnerait que ce soit le cas du suivant. Et pourtant, il figure pour moi parmi les jeux les plus intéressants dans leurs expérimentations que j’ai pu faire l’an dernier, et ce sans demander un investissement monstre (financier déjà, le jeu étant actuellement à moins de 10 euros, mais temporel également, celui-ci ne prenant pas plus de 4 heures à terminer). Il s’agit de Stories Untold, développé par le studio britannique (encore, décidément) No Code et sorti en 2017, année particulièrement chargée en grosses références. Celui-ci prend la forme, ou plutôt les formes, d’un jeu d’aventure textuel, mais aussi d’un point’n click en écrans fixes, ou encore d’un walking simulator, le tout enrobé dans une ambiance allant du mystérieux au relativement oppressant, sans jamais dénoter avec le reste de l’expérience. Pour les quelques personnes ayant éventuellement essayé la démo, que ce soit à l’époque ou de nos jours, il est assez difficile de s’imaginer jusqu’où peut aller le concept, dans la mesure où seul un fragment nous est donné, celui du jeu textuel. Celui-ci vient également avec un twist, car certains événements décrits dans la partie texte se répercutent également dans l’environnement réel. Car, bien que décrit à la base comme un jeu d’aventure textuel, l’ordinateur sur lequel se déroule cette partie est clairement visible, nous donnant une vision complète sur le bureau du protagoniste. Et bien que plusieurs autres ruptures de cadre ou effets de style soient de la partie par la suite, ce premier épisode pose déjà de solides bases sur ce à quoi va ressembler l’expérience par la suite. Et oui, c’est un jeu épisodique comme c’était « un peu » la mode pendant la période de sa sortie (Life is Strange, les jeux Telltale, ou encore le dernier Dreamfall), avec encore un fois un twist, celui de proposer une expérience radicalement différente à chaque nouvel épisode. Plutôt impressionnant de maîtrise quand on sait que No Code, son développeur, en était à sa première production.
Comme évoqué précédemment, le premier épisode se concentre sur la partie text based adventure. Dès le lancement du jeu, nous sommes accueillis par une scène fixe de bureau, sur lequel un micro-ordinateur des années 80, type Commodore 64, est installé. Sur son écran, et au son lancinant du lancement typique d’un programme sur support cassette, charge un jeu qui fera office d’intrigue pour ce premier épisode, The House Abandon. Et là est la première rupture avec son contexte de sortie. Un texte de description s’affiche, donnant le contexte de départ, et un prompt (un vrai, pas ce que font de nos jours les arnaqueurs en LLM) nous invite à entrer des commandes. Pas plus de contexte autre que celui induit par le texte, juste une invitation et la confiance sur ce qui nous est demandé. Cela m’étonnerait que je vous apprenne quoi que ce soit, mais ce type d’interface austère n’est pas vraiment ce qu’on attend de voir dans un jeu sortant à la fin des années 2010, et dont la présentation externe nous offre une modélisation plutôt « réaliste ». Particulièrement radical dans son approche, ce premier segment est censé faire office de contrat tacite avec le joueur. Voici le genre de proposition que je vais développer tout au long des quatre heures composant mon aventure. De là, à vous de l’accepter et de vous laisser déstabiliser un peu. L’histoire de cet épisode, en substance, retrace le retour et l’exploration d’une maison abandonnée par une personne y ayant habité, mais ne pouvant plus s’en approcher pendant longtemps à cause d’un évènement tragique ayant touché sa famille. La progression, au début plutôt classique pour ce genre de jeu (utilisation des termes acceptés par le moteur, interaction avec des éléments contenus dans le texte de chaque « écran » pour avancer, etc.), prendra assez vite une toute autre tournure lorsqu’on se rendra compte que nos interactions dans la maison du jeu auront l’air de se répercuter dans notre propre maison, modifiant de fait totalement l’atmosphère, à la base jouant surtout sur le mystère, vers quelque chose de plus horrifique, à l’angoisse presque littéralement palpable. D’autres jeux ont peut-être déjà utilisé ce procédé avant, il ne faut pas oublier que le jeu vidéo est riche de plusieurs décennies d’histoire, et que des expérimentations autour de genres nouvellement créés se faisaient dès les années 80. Mais malgré tout, je trouve ce premier chapitre magistral, que ce soit dans son concept, son rythme, la montée de la tension à la frontière du meta, tout me paraît sublimement bien pensé en terme de cohérence globale.
Et je vais m’arrêter là. Inutile de vous gâcher la potentielle découverte en évoquant des procédés dépassant le cadre de l’épisode 1 (qui, je le rappelle, est gratuit). Mon but tous les ans et de vous inviter à découvrir les principaux jeux m’ayant marqué tout au long de l’année, d’en dire un maximum dans les limites de ce que j’estime nécessaire pour en faire la découverte sereinement derrière. Ce qui peut parfois me conditionner dans mon approche et peut-être donner une impression à la lecture que je survole le sujet, bien que j’essaie au maximum de développer tout ce qui me semble pertinent pour donner envie. De plus, là on parle d’un jeu de 4h. Cela rend l’exercice d’autant plus périlleux, dans la mesure où le game design et l’histoire se répondent très étroitement dans Stories Untold, et expliciter certains pans de gameplay peut gâcher la découverte à la fois de ce qu’il raconte, mais aussi et surtout comment il le raconte. Sachez juste que celui-ci mérite très largement votre intérêt (et les deux soirées maximum que vous lui accorderez), surtout si vous aimez les procédés narratifs dans le jeu vidéo. Tout ce que je peux rajouter, c’est que le fait de laisser à No Code le soin de développer un des prochains Silent Hill, le dénommé Townfall, prend absolument tout son sens quand on voit ce qu’ils racontaient déjà dans Stories Untold, et à quel point leur approche expérimentale de la narration par le gameplay s’inscrit magnifiquement bien dans ce vers quoi la série tendait à partir de Silent Hill 4, et dans des projets comme Shattered Memories ou encore le regretté P.T. Sans compter leur évolution sur Observation, leur second jeu, dans lequel nous jouons le rôle d’une intelligence artificielle dans une base spatiale, à la fois conditionnée par l’équipement de celle-ci et particulièrement libre dans notre progression, le tout enrobé dans une intrigue confinant à l’horreur cosmique et aux boucles temporelles, sur fond de mystère qu’on pourrait rapprocher un peu d’un 2001 : L’Odyssée de l’Espace (mais qui raconte des trucs du coup contrairement à ce film). Au final, en plus de Stories Untold dont j’ai déjà énoncé les grandes qualités et pour qui j’ai clamé tout mon amour, je vous invite également à découvrir Observation, qui expérimente aussi à sa manière sans faire dans la redite de leur précédent jeu. Dans tous les cas, gardez un œil sur No Code, j’ai bon espoir que ce studio n’a pas fini de nous émerveiller avec des concepts simples mais poussés à leur paroxysme. J’ai tellement hâte de la sortie de Silent Hill Townfall.
4. WORLD OF HORROR
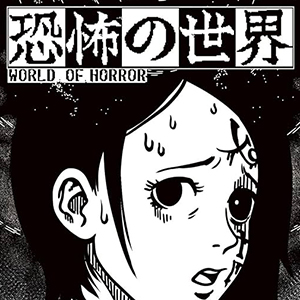
Le prochain jeu est à la fois assez évident compte tenu de mes goûts en matière d’esthétiques sombres et d’horreur cosmique prononcée, et complètement contre-intuitif vis-à-vis de mes affinités en termes de modes de jeu. Et pourtant, c’est par son biais (et le jeu suivant également) que tout un pan du jeu vidéo s’est débloqué pour moi. Car si conceptuellement la classification de roguelike (et roguelite) me fascine quand je l’aborde par le prisme de l’analyse du game design, j’en viens généralement à assez peu me sentir stimulé par ses boucles de gameplay, qui ne me passionnent pas vraiment, bien au contraire (au point de laisser sur le côté des jeux comme Hadès, dont je suis pourtant sûr du potentiel et de la qualité, surtout en prenant en compte mon amour pour les précédentes production de Supergiant Games, mais dont la forme m’a fait lâcher l’expérience au bout de quelques heures). Pourtant, tout va changer avec World of Horror. Se présentant sous la forme d’un RPG aux éléments de point’n click, très caractéristique des productions du genre sur micro-ordinateur dans les années 80, World of Horror est avant tout un roguelike tirant son esthétique de l’incroyable travail du désormais célèbre mangaka Junji Ito, l’un des chefs de file du manga horrifique. Initialement prévu comme un jeu de carte, plusieurs démos en jeu vidéo verront finalement le jour à partir de 2016, avant que le jeu entre en early access en 2020, avant d’enfin s’offrir une release en 2023. Un travail de longue haleine donc, ce qui n’est pas étonnant quand on sait que le projet est le fruit du travail d’une seule personne, Paweł Koźmiński (sous le pseudonyme Panstasz), dont ce n’est même pas l’activité principale (celui-ci, tout comme Ito, étant à la base dentiste, et n’ayant pas arrêté son travail lors du développement). À ce jour, World of Horror est disponible sur la majorité des plateformes actuelles, à l’exception de l’écosystème Microsoft, et c’est pour la version Switch que j’ai personnellement craqué, celle-ci s’octroyant même une sortie sur support physique. Si l’influence principale reste les œuvres de Junji Ito, Panstasz ira chercher d’autres références, notamment dans le cinéma de genre des années 80, très prolifique en terme de body horror, mais également dans l’incroyable terreau que fut l’âge d’or de la J-horror (1996-2007 environ, les dates exactes sont mouvantes selon les films qu’on veut faire rentrer dedans, mais c’est ma plage de temps personnelle). Et, bien entendu, les écrits d’Howard Philips Lovecraft, dont l’ombre plane depuis maintenant un moment sur l’imaginaire fantastique et horrifique, et qui structurera partiellement le game design de World of Horror.
Comme dit précédemment, le jeu prend la forme d’une RPG très caractéristique du milieu des années 80, avec une interface fournie et une navigation se faisant quasi exclusivement au pointeur (même sur console, ce dernier étant dirigé par le stick gauche). Ajouté à cela la direction artistique faisant la part belle aux graphismes pixel art 1bit (seulement deux couleurs possibles à l’écran, par défaut noir et blanc), les variations de format et cassages de codes, et on obtient un jeu dont l’introduction à l’univers peut paraître particulièrement compliquée. Les références ludiques qu’il tend à convoquer sont archaïques, les systèmes de jeu assez cryptiques, et ce malgré un scénario tutoriel, et l’intransigeance de sa progression n’aide vraiment pas à le rendre accessible à un public plus large que la niche très restreinte qu’il convoque. Et, même si je vais quand même développer mon propos pour donner un minimum envie d’y jouer, ça va m’être difficile de le dépeindre comme un jeu qui peut plaire à tout le monde. Ce n’est bien entendu pas le cas, et ce qui m’a attiré chez lui est justement sa singularité, ainsi que toutes les références, elles aussi de niche, qu’il utilise, réassemble, manipule à sa guise pour donner un tout cohérent avec son concept de base, mais aussi particulièrement hermétique et expérimental. Commençons par le contexte narratif du jeu. L’histoire se situe à Shiokawa, petit ville rurale japonaise, en 198X. Depuis peu, un nombre conséquent d’évènements étranges ébranlent la tranquillité des lieux, entre disparitions, silhouettes encapuchonnées rodant aux abords de la ville, voire même d’ignobles créatures apparaissant sporadiquement, plongeant Shiokawa dans une peur constante. La progression des nouvelles technologies, salutaire sur bien des points, amène également son lot de dangers, et des dieux anciens, jadis régnant sur Terre et nous observant désormais depuis le cosmos, s’éveillent de leur repos millénaire, risquant de briser jusqu’à la réalité même. Vous jouez le rôle d’un lycéen ordinaire, plongé dans le chaos que représenté cette période, votre santé mentale ne tenant qu’à un fil. À vous de mener l’enquête sur plusieurs cas étranges faisant régner la terreur dans tout Shiokawa, et de peut-être comprendre le mystère entourant le phare de la ville, qui semble être l’épicentre même de la folie qui rôde dans les rues.
Si ce résumé peut aisément rappeler Spirale, œuvre phare de Junji Ito, dans laquelle une multitudes d’évènements étranges mènent à la folie croissante de la ville, jusqu’au chaos le plus absolu, l’empreinte du travail de Lovecraft y est également évidente. Divinités anciennes rôdant dans les abîmes du cosmos, cultes étranges, créatures émergeant de la mer, son influence est absolument partout. Et, comme évoqué en introduction, cela devient évident dans le gameplay. Une partie classique de World of Horror commence comme suit : un personnage nous est attribué, avec ses statistiques générées aléatoirement, puis une divinité cosmique en sommeil est appliquée à la partie. Le but de chaque run est de résoudre cinq affaires étranges dans la ville, nous octroyant chaque fois une clé, qui servira à ouvrir l’un des cinq verrous à l’entrée du phare. Et une fois que cela est fait, direction le haut du phare, afin d’empêcher le réveil de la divinité en sommeil dans notre partie. Un objectif clair, simple, mais diablement efficace dans son exécution. Tout d’abord, car la moindre action est régie par le temps. En effet, afin de lier la narration avec le gameplay, la run se dote d’une jauge, appelée doom meter, qui se remplit progressivement tout au long de la progression, et sonne la fin de la run si elle atteint cent, faisant immédiatement vivre ce sentiment d’urgence dépeint dans le résumé, car remplir intégralement la jauge signifie à la fois le réveil du dieu et la fin de la partie. Car là est la force de World of Horror. Nous impliquer avec peu, mais de la bonne manière. Par exemple, chaque nouvelle partie commence dans notre appartement. Quelques actions sont possibles avant de partir pour notre première affaire, comme par exemple fouiller les placards pour éventuellement récupérer des items, prendre une douche (qui peut soit nous octroyer un bonus d’expérience, soit guérir notre santé physique ou mentale), ou encore choisir une tenue. Notre personnage a une existence propre dans ce monde, il habite à Shiokawa et a des préoccupations et activités crédibles.
Outre la référence évidente à Silent Hill 4, qui articule toute sa progression autour de l’appartement d’Henry et nous fait donc y retourner régulièrement entre les niveaux, cela nous donne un point d’ancrage à la fois narratif et ludique. Chaque affaire complétée nous renvoie à notre appartement, nous permettant de souffler un peu malgré l’intensification de la menace à mesure que le mystère se résout. Concernant les affaires en elles-mêmes, la progression se fait à partir d’une carte simplifiée de la ville, dans laquelle on pourra sélectionner le lieu à explorer. Plusieurs actions sont possibles dans ceux-ci selon leur nature, que ce soit le centre-ville où il est possible de faire ses courses (et dont le vendeur est d’ailleurs un shiba inu), l’hôpital pour se faire soigner, l’école pour recruter des acolytes, ou encore notre propre appartement pour nous y reposer. Mais celle qui fait avancer l’affaire est l’exploration des lieux, menant à tout un tas de rencontres aléatoires, dont la résolution se fait soit via des jets de dés (et donc basés sur la fiche de personnage), soit lors de combats au tour par tour, qui mêlent interface de magie, d’attaques physiques ou encore actions spirituelles (comme les prières). Chaque action coûte un certain nombre de points dans une jauge d’actions spécifique, permettant de mélanger les actions disponibles tant que celle-ci n’est pas chargée au maximum. Deux paramètres sont à prendre en compte, l’endurance (qui est la santé physique) et la lucidité (prenant le rôle de la santé mentale), menant chacun à une fin de partie si l’un d’eux tombe à zéro ou en dessous. Sachant qu’il est possible de sauver sa run pendant les combats si l’une ou l’autre tombe à zéro en le faisant remonter, seule la fin du combat compte, alors attention à ne pas être à zéro ou en négatif sur ces jauges. À savoir que par souci d’identification et pour renforcer l’aspect narratif, la dégradation de la santé physique et mentale se répercute sur le modèle de notre personnage. Une grande variété d’affaires est proposée, aux références variées et aux résolutions multiples selon les pré-requis des fins. Puis à la fin d’un scénario, on retourne se reposer à l’appartement après avoir trouvé l’une des clés du phare dans sa boîte aux lettres, et on est prêt à repartir faire les autres jusqu’à débloquer l’accès au phare, qui condense toutes les mécaniques dans un seul niveau. Et au sommet, le dieu cosmique attend, silencieux, implacable, que la jauge de doom se remplisse, menant à son inexorable réveil et la destruction de la réalité telle qu’on la connaît.
Difficile de ne pas s’épandre plus encore sur un jeu aussi dense, tant dans ses divers emprunts que dans sa proposition, qui nous fait constamment jouer sur le fil en flirtant avec l’horreur cosmique dans sa forme la plus immédiate. Mais sachez ceci, ce jeu est véritablement maudit. Tout paraît étrange, corrompu, la moindre action peut avoir des répercussions dramatiques et son game design joue beaucoup avec ce sentiment, au point de parfois paraître juste hanté. C’est subtil au début, mais plus on multiplie les runs, et plus cela nous saute aux yeux. Quelque chose se cache dans les profondeurs mêmes de World of Horror. Et en tant que passionné d’horreur, c’est probablement l’une des expériences les plus fascinantes que j’ai pu parcourir ces dernières années, au point d’y mettre plusieurs dizaines d’heures alors que je le rappelle, le roguelike n’est pas vraiment ma tasse de thé. Et j’ai l’impression d’en avoir survolé l’analyse alors que je me suis pourtant plus étalé que sur les autres jeux, mais je peux vous assurer que si l’horreur cosmique, le travail de Junji Ito, le format roguelike ou encore l’esthétique des vieux RPG, point’n click et dungeon crawlers du milieu des années 80 vous parlent, voire vous fascinent comme moi, je pense sincèrement qu’il n’y a aucun risque pour que vous n’appréciiez pas la découverte. L’inévitable vous attend.
5. Baroque
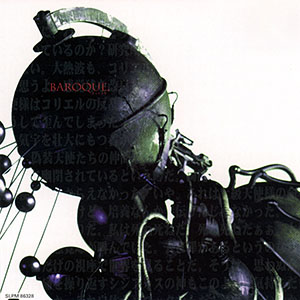
Après avoir fait l’éloge de quatre jeux qui m’ont durablement marqué et se sont hissé chacun assez haut dans la liste de mes références, il est maintenant temps d’aborder un autre type de révélation. Celle qui parvient non seulement à rentrer dans cette fameuse liste de jeux à recommander, mais également à en devenir une obsession, une œuvre qui résonne entièrement avec à la fois nos goûts et par extension les fondements mêmes de notre personnalité. Cela peut paraître exagéré, et j’en conviens, mais il était important pour moi de dépeindre Baroque de cette manière, pour vous faire comprendre à quel point cette expérience m’a bouleversé. Et si celui-ci à tellement résonné en moi, c’est probablement en partie dû à mon intérêt désormais prononcé pour l’horreur et les esthétiques sombres, dont l’hyperfocus s’est particulièrement ancré tout au long de l’année, en plus des cloisons qu’avaient déjà abattues World of Horror concernant mon approche du roguelike. J’ai dû apprendre son existence dans le courant des années 2000, à l’époque où j’avais très peu de jeux à disposition, et clairement pas les connaissances en informatique que j’ai actuellement (je ne savais pas comment faire fonctionner un émulateur, c’est dire). Durant cette période, j’avais pour habitude de parcourir des listes entières de jeux, généralement filtrées par genre, me perdant au gré des pages sans toujours parvenir à me faire une idée de ce sur quoi je me renseignais. Une bonne partie du temps, ces jeux bénéficiaient d’une démo, me permettant d’expérimenter l’espace de quelques minutes un titre dont la globalité me resterait malgré tout obscur (mais qui m’a parfois laissé une souvenir à la fois tenace et fugace, surtout vingt ans plus tard), mais pour les autres, je devais me contenter de quelques screenshots, un test vidéo de piètre qualité à l’occasion, et c’était tout. C’est dans ce contexte que j’ai vu passer Baroque, lors de mon passage en revue du catalogue RPG de la Playstation. Très vite, l’information m’est parvenue : pas de traduction, ne serait-ce qu’anglaise, le jeu était « bloqué » au Japon. Par chance, une version Playstation 2 semblait exister, à l’esthétique quelque peu différente, mais en l’absence de connaissance en terme d’émulation, ni d’endroit où trouver une éventuelle ROM, et encore moins les moyens pour me payer une copie physique (n’ayant à l’époque même pas la console, voire carrément aucune), le peu que j’avais appris à son sujet a peu à peu quitté ma mémoire.
Jusqu’à ce fameux jour où, suivant depuis peu la chaîne de RagnarRox (dont j’avais déjà parlé), je vis arriver dans mon fil YouTube sa vidéo sur le sujet. L’accroche, évocatrice, m’a immédiatement fait cliquer sur la miniature : « Rebirth of a Cult Classic Horror RPG ». Soit les deux genres majeurs qui ont depuis toujours façonné mon approche du jeu vidéo. Si le versant RPG est présent depuis plus de vingt ans dans mon imaginaire, grâce notamment à cette pierre angulaire de ma vie qu’est Morrowind, la frange horrifique du medium a mis bien plus de temps à se manifester, et l’immense avantage de l’arrivée de ce sujet, c’était que mon hyperfocus pour ce sous-genre commençait tout juste à devenir incontrôlable. Outre l’excellente qualité du travail de Ragnar (en plus d’avoir plus ou moins les mêmes intérêts spécifiques que moi), cette vidéo en faisant évidemment partie, ce qui a le plus ravivé ces maigres souvenirs que j’avais de Baroque était une information qui allait absolument tout changer. Baroque avait enfin droit, presque 25 ans après sa sortie, d’une fan traduction en anglais, me permettant de m’y essayer pour la première fois. Et même si, au vu de mes goûts du moment, je me doutais que l’expérience me plairait, je n’avais pas prévu qu’elle résonne aussi fort en moi, au point de considérer Baroque (du moins, la version PS1, mais on y reviendra) comme l’une de mes œuvres favorites de ces dernières années, se hissant même dans mon imaginaire top 10, qui change environ tous les 6 mois, de mes jeux préférés de tous les temps. Je pense avec le recul que sa structure, finalement assez proche du premier Diablo, a sûrement joué un rôle dans mon appréciation de l’expérience, ce dernier figurant (avec Diablo 2, évidemment, et encore plus celui-ci) dans cette fameuse liste des jeux qui ont défini mes goûts et contribué à développer mon univers mental. C’est d’ailleurs le sujet d’une prochaine série de chroniques que j’aimerai écrire, mais on s’y penchera en temps voulu. Mais comme il est de rigueur, un contexte, du jeu en lui-même et de son narratif, s’impose.
Initialement sorti en 1998 sur Saturn, puis l’année suivante sur Playstation, Baroque est un dungeon crawler en temps réel intégrant des mécaniques de survie et de roguelike, le tout enrobé dans un univers sombre post-apocalyptique, dont l’esthétique et certaines thématiques se rapprochent de l’horreur. Pour exposer simplement le concept, voyez ça comme une variante de la formule de Shin Megami Tensei, remplaçant le déplacement case à case par une caméra relativement libre, toujours à la première personne (dont l’axe Y, haut/bas, est néanmoins bloqué, et où les gâchettes remplacent le second stick, encore assez peu utilisé sur PS1, et tout simplement inexistant sur Saturn). Un seul personnage nous est proposé, les affrontements se font en temps réel, et l’aire de jeu est structurée à la manière du premier Diablo, à savoir un village (ici l’Outer World), qui sert de point de départ, et un gros donjon segmenté en niveaux, la Nerv Tower, dont le contenu est généré de manière procédurale. La mort signifie la fin d’une run, et donc le retour à l’Outer World et la régénération des niveaux de la Nerv Tower. Concernant la partie « survie », ce n’est pas à rapprocher de ce qu’on entend par là en 2025, soit une gestion de plusieurs jauges, représentant chacune une ressource particulière et le tout dans un espace hostile nous poussant à dresser des constructions pour nous protéger de la plupart des dangers dont les éléments. Là, une seule jauge décroît sur la durée, la vitalité, et se remplit d’une façon bien plus simple : en récupérant une ressource spécifique qu’on obtient soit en consommant des cœurs trouvé au gré des niveaux, soit en tuant des adversaires. En soi, tant que le niveau de vitalité n’a pas atteint zéro, aucun réel danger n’est à constater (hormis, bien entendu, de se faire tuer au combat). Par contre, dès que celle-ci s’est complètement vidée, la santé va elle aussi commencer à décroître, et ce jusqu’à la récupération d’un peu de vitalité, ou bien la mort. Tout ceci va induire un sentiment de stress constant, nous faisant d’autant plus adhérer aux boucles de gameplay, et surtout, nous poussant à nous mettre en danger. Car en l’absence de cœurs (et c’est généralement le cas lorsque notre vitalité tombe à zéro), c’est uniquement dans le massacre d’adversaires à la chaîne que va se jouer notre salut. Tout en sachant que plus on descend dans les profondeurs de la Nerv Tower, et plus les ennemis sont ardus, renforçant ce sentiment de fragilité constante, périodiquement contrebalancé par la montée en puissance (niveaux ou équipement). Et bien que de l’extérieur je croyais assez peu en ma capacité à me laisser embarquer par une telle proposition, force est de constater que c’est diablement efficace (en plus de rappeler certaines mécaniques semblables arrivées bien plus tard, comme par exemple dans Bloodborne). Concernant la partie histoire du titre, je vais essayer de faire court.
Tout commence dans le courant des années 2020, lorsqu’une équipe de chercheurs japonais découvrit une toute nouvelle forme de vie, qu’ils nommèrent « Perception ». Grâce à celle-ci, de nouvelles matières purent être détectées, et l’existence de sphères étranges, capables d’absorber et corriger d’autres matériaux, fut mise au jour, ainsi que la certitude que celles-ci étaient des sortes d’organes sensoriels pour une autre forme de vie, localisée loin sous la surface de la planète. Au vu de l’importance de cette dernière, une hypothèse émergea au sein des chercheurs. Cela ne pouvait qu’être Dieu. Cette équipe, désormais dédié à l’étude de ce mystère, prit le nom de Koriel. Parmi eux, un certain Tenjou Kyuushiro parvint à mettre au point un programme de réalité virtuelle, dont le but était très simple : prouver l’existence de Dieu. Mais celui-ci, désormais éveillé, commenca à instiller la folie sur l’intégralité de la surface du globe, qui mena peu à peu à des vagues de meurtres qu’on appelle les Meurtres Baroque, ravageant les villes et menant à une contamination psychotique massive. Puis un jour, la Nerv Tower apparut de nulle part, engendrant la Grande Vague de Chaleur qui ravagera la Terre et ses habitants. La quasi intégralité de la population disparût en un éclair. Les survivants, dont l’extrême majorité a muté en entités démoniaques appelées les Grotesques, n’est désormais plus que l’ombre de ce qui fut la population de la planète, et la peur de basculer dans la folie pour finir par muter à son tour accable la poignées d’entités vaguement humaines résidant désormais dans les ruines de la planète. Mais un espoir subsiste peut-être. Car dans les profondeurs de la Terre réside toujours la divinité responsable de l’état déplorable du monde. Nous, un protagoniste non nommé et au passé quasi inexistant, sommes donc chargé par l’Ordre Malkuth, religion rassemblant la majorité des survivants après les ravages de la Grande Vague de Chaleur, de descendre dans les profondeurs de la Nerv Tower afin de tuer Dieu une bonne fois pour toute, et ainsi espérer mettre fin à ce cauchemar.
À la lecture de ce court résumé, je pense que vous avez déjà compris pourquoi ce titre m’avait intrigué pendant si longtemps. Sombre, cryptique, mêlant science-fiction, horreur et mysticisme religieux, Baroque avait depuis tout ce temps absolument tout ce qu’il fallait pour m’accrocher, maintenant que mon intérêt pour l’horreur et les univers sombres est au plus haut. Ne restait que l’aspect rogue-lite qui me rebutait légèrement, bien que mes craintes de ne jamais en voir le bout ne se fussent légèrement estompées lorsque j’appris que sa durée de vie n’excédait pas les quinze heures. Un scope très largement honorable pour prendre le temps de développer son intrigue et ses thématiques, tout en évitant de me faire perdre mon intérêt au fil des runs. C’est donc relativement confiant que je lançais le jeu, les éloges de Ragnar en tête et fort de mon expérience sur World of Horror. Et même si cela était présent dans sa vidéo, je ne m’attendais vraiment pas à ce que j’ai vécu tout au long de mon playthrough. Car si les mécaniques restent assez attendues pour un dungeon crawler à la première personne dont la structure est inspirée de Diablo, ce qui m’a le plus impressionné, surtout en prenant en compte la date de sortie du jeu, c’est son approche unique de la narration. À l’instar de ce qu’on ne verra que plus tard se développer (Silent Hill 2 trois ans plus tard par exemple), le moindre élément du jeu a du sens dans la narration, et se permet même d’être ouvert à plusieurs interprétations. Les dialogues des différents PNJs, dans l’Outer World comme dans la Nerv Tower, sont cryptiques et parfois évasifs, les quêtes que certains nous donnent font véritablement avancer l’intrigue et donnent du corps à l’univers global, sans jamais être de trop, et même le système de stockage des objets en prévision d’une prochaine run a du sens dans le monde. Déjà, cet aspect est issu du Baroque d’un des habitants de l’Outer World (traduit en Things Thing, car la plupart des personnages hors Ordre Malkuth sont appelées des Things, ou Choses), dont l’obsession à tout accumuler a généré cette anomalie (l’une des évènements qu’on appelle Baroque, et qui sont la manifestation des désillusions des survivants, lorsque celles-ci atteignent un point incontrôlable). Et les sphères dans lesquelles on jette nos items pour la run d’après, les Sense Spheres, sont des points sensibles de Dieu, et sont reliées à certains endroits de la surface, dont aux abords de notre village de l’Outer World. À noter que les Sense Spheres sont également les fameux organes sensoriels de Dieu évoqués dans mon court résumé, ce qui donne un poids considérable à un simple élément de game design, à la base prévu pour justifier le stockage d’items dans le jeu. Et c’est le cas pour tout le reste, comme par exemple l’élément qu’on récupère en tuant des Grotesques pour régénérer notre vitalité. Celui-ci est en fait la Perception, par quoi tout à commencé, laissant au passage un boulevard d’analyse et d’interprétations diverses quant à la nature de notre protagoniste, des Grotesques ou par extension de Dieu. Et je rappelle qu’on est en 1998 sur Saturn lorsque le jeu sort pour la première fois. La narration, en plus de mettre le joueur au centre de l’intrigue et de sa compréhension, se permet même d’être très en avance sur ce qu’on verra dans des projets sortis une à deux générations plus tard. Sans compter la découverte progressive des mécaniques de jeu de manière naturelle et créative, donnant un aspect expérimental à la progression même du joueur.
Je pourrais continuer encore longtemps, mais cela ne ferait que vous perdre dans d’interminables paragraphes explicatifs d’un jeu qui se doit d’être joué pour être compris et correctement digéré. De plus, une grande partie de ma compréhension, plus encore que par mon expérience de jeu, vient d’un incroyable site Internet compilant une masse de données à la fois conséquente et très précise pour un jeu dont l’accès hors du Japon était si longtemps trop compliqué pour la majorité d’entre nous. Entre un guide complet (Saturn et PSX), comprenant notamment l’intégralité des objets du jeu, les transcriptions de toutes les cinématiques, des interviews de l’équipe de développement, des versions traduites des romans ayant servi de base au jeu, des sources de travaux préparatoires ou encore une foule d’analyses, allant parfois vraiment dans le détail, vous avez largement de quoi vous perdre pendant des heures, en plus du temps que vous aurez mis dans le titre. Je voulais prendre le temps d’évoquer les versions PS2 et Wii, mais n’ayant que trop peu joué, je peux juste vous dire que si le gros de l’histoire, des mécaniques et du concept global sont là (bien que le jeu soit passé à la troisième personne), sa narration cryptique et son esthétique weird et cauchemardesque ont été considérablement amoindris, le choix de rendre les dialogues et cinématiques plus évidents et de passer à une direction artistique plus typée « anime » desservant considérablement la volonté d’origine. Des retours que j’ai cependant, cela reste des versions plutôt solides, bien que ces changements les rendent bien moins attrayantes à mon goût. Si vous décidez de vous lancer dans l’expérience, je ne saurai que trop vous conseiller la version Saturn ou Playstation, les deux ayant à priori quelques différences dans les dialogues et le rendu, plus contrasté sur Saturn. Dans tous les cas, quelle que soit la version que vous choisirez, si vous aimez les expérimentations narratives et visuelles, les esthétiques sombres allant au bout de leur concept, et tout simplement des jeux à l’approche radicale, je ne peux que vous enjoindre à vous essayer à Baroque. Car c’est une expérience qui vous hantera longtemps, très longtemps après l’avoir terminée. Je peux vous l’assurer.
Conclusion
Contrairement à 2023, riche en tonnes d’activités associatives et créatives, de rencontres et interactions en tous genres (et ce, malgré un dernier trimestre abominable), l’année 2024 a été plutôt calme. Mais un calme doux, profondément salvateur, et nécessaire après les mois qui l’ont précédé. Rien de spécialement notable ne s’est passé, si ce n’est une augmentation significative des jeux terminés, et ce du simple au double par rapport à l’année précédente. Au total, des 31 jeux terminés en 2023, j’ai atteint les 72 en 2024, avec une année qui a débuté « normalement » avec beaucoup de genres représentés. Puis, dans le courant de l’été, comme dit en introduction, un changement drastique s’est opéré. Cela faisait des années que je lorgnais du côté de l’horreur, suivant des chaînes Youtube anglophones très précises sur le sujet, aux essais vidéo particulièrement longs et complets, sans jamais vraiment m’impliquer, pour ainsi dire. Mais à partir du mois de juillet, mon obsession s’est finalement développée, timidement au départ, avec des projets comme Beacon Pines (un jeu narratif à multiples embranchements qui pioche dans l’horreur pour installer son atmosphère et développer certaines mécaniques), puis à pieds joints avec mon rattrapage de Paratopic, puis la découverte de Still Wakes the Deep, de thechineseroom (à qui l’ont doit notamment Everybody’s Gone to the Rapture, Dear Esther ou encore Amnesia A Machine for Pigs), qui a fait céder les dernières barrières. Le reste de l’année a ensuite consisté à partager mon temps entre rattrapages de titres évidents, comme Outlast, Layers of Fear ou même Clock Tower, et plonger dans le côté beaucoup expérimental et radical de l’horreur, dans tous les sens du terme. Et bien que cela puisse paraître contre-intuitif de prime abord, cela m’apaise énormément de prendre une grande partie de mon temps dans ces esthétiques, qui font tout pour paraître repoussantes de l’extérieur, mais qui cachent en elles une richesse folle et une sincérité parfois vraiment touchante de la part des acteurs et actrices de la scène.
Et je le dis d’avance, 2025 sera rempli à raz bord de références horrifiques plus ou moins accessibles, car c’est dans cette direction que j’ai décidé de partir maintenant, tout en essayant de ne pas trop délaisser le reste quand même. Ces dernières années étaient particulièrement longues et difficiles, mais à l’heure où j’écris ces lignes, sachez que pour la première fois depuis très longtemps, ça va. En tout cas, j’ai maintenant la certitude que ça ne pourra plus descendre aussi bas qu’avant, que j’ai les armes pour faire face aux potentielles difficultés prochaines, et que si mon état recommence à descendre dangereusement, je sais maintenant vers qui et quoi me tourner. Comme évoqué dans ma précédente rétrospective, sortie à quelques mois d’écart si vous suivez, j’ai désormais récupéré toute l’énergie et l’envie nécessaires pour reprendre l’écriture. Il ne faudra pas s’attendre à des sorties récentes, parce que je connais désormais mes limites et préfère ne rien sortir pendant des mois pour conserver un équilibre dans ma vie, mais j’ai beaucoup d’idées. Et les nouvelles vont également reprendre. Doucement, sans me mettre de pression. Pour tout vous dire, j’en ai déjà deux en cours depuis des années, donc rien que me concentrer dessus va prendre du temps. Mais ça viendra. Encore désolé pour la taille conséquente des paragraphes des deux derniers jeux. Ils auraient, je pense, presque mérité un article dédié, mais j’avais besoin de développer, surtout pour Baroque, qui a été une véritable révélation au point de le compter dans la liste de mes jeux préférés de tous les temps. Et pour ce qu’il m’a apporté, tant sur le plan analytique que personnel, ses thématiques ayant très intensément résonné en moi. Comme le veut la tradition, vous trouverez le tableur de mes jeux de 2024 sur ce lien. Je n’ai plus qu’à vous dire à l’année prochaine, celle-ci n’étant plus très loin !